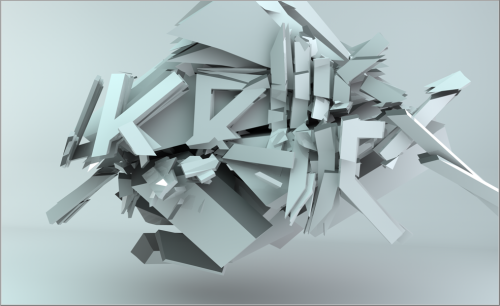Nous reproduisons ci-dessous un excellent point de vue de Claude Bourrinet, cueilli sur Voxnr et consacré à la France invisible, laminée par la crise et l'américanisation des moeurs...

Autopsie d'un deuil
Dans quelle partie la vérité de la société française contemporaine se manifeste-elle le plus ? Il faudrait un échantillon qui échappât aux contaminations de l’idéologie, aux miasmes du journalisme, et à la myopie de l’actualité. Les tribulations de la « racaille » de banlieue, ou celles de tel acteur populaire, entrent dans cette catégorie peu ragoûtante, avec les orgies et farces tristes de la France d’en haut, dont l’on conviendra qu’elles ne sont, ni les unes, ni les autres, représentatives du pays réel, bien qu’elles en constituent une partie significative. La belle étude du sociologue Christophe Guilluy, Fractures françaises (François Bourin Editeur) a mis récemment en évidence le déséquilibre en partie voulu entre certains secteurs médiatisés à outrance, et exhibés avec tout le pathos possible pour en faire un centre d’intérêt susceptible de promouvoir un certain type de société, et d’autres secteurs, occultés, ignorés ou méprisés, bien qu’ils secrètent des problèmes, notamment de pauvreté et d’abandon, autrement plus aigus que les premiers, lesquels bénéficient de toute la sollicitude des pouvoirs publics.
La France obscure, banalement quotidienne, et souvent paisiblement, passivement, tragiquement installée dans sa pauvreté, son désespoir ou son amertume, paraît représenter ce que nous cherchons, un échantillon significatif de ce que nous sommes devenus. Un endroit isolé, oublié, sera, à coup sûr, un exemple a fortiori de notre société, et d’autant plus symbolique qu’il n’est apparemment pas touché par certains maux emblématiques qui bouleversent notre nation, comme l’immigration massive, les délocalisations, l’urbanisation sauvage etc. Et néanmoins, nous verrons que ce coin écarté, semble-t-il, de l’histoire en train de se faire, reçoit violemment, bien que sans protestation, les forces destructrices de la modernité.
Appelons donc ce village Sainte Hermine les Sylves, et la région qui l’environne le Duboisais. Cela fera bucolique. Et, en effet, le pays est superbement tapissé de forêts, que rongent des prés parfois dévalant en pente douce. Car c’est aussi une terre de collines, de rochers. Voilà le décor planté. Notons que le terme « pays » a ici une résonance bien précise, puisqu’il désigne un territoire un peu supérieur au canton, en gros ce que peut parcourir un homme à pied en une journée. C’est d’ailleurs ce qui correspondait à la vie pratique des éleveurs, qui se rendaient pour deux ou trois jours à des comices, avec bétail et produits fermiers. Il n’était pas question, il y a cinquante ou cent ans, de bétaillères. L’on n’avait pas peur de marcher. Du reste, les déplacements étaient rares, et uniquement mus par des raisons majeures. Certains vieillards, encore, avouent ne s’être rendus à un village éloigné de dix kilomètres qu’une seule fois dans leur vie, et ignorer complètement les villes voisines. Pour une part, l’univers paysan est encore borné par l’horizon, bien que nombre d’éleveurs n’hésitent pas à se rendre au Salon de l’agriculture. Et même il leur arrive de prendre des vacances, et de se rendre à la mer.
C’est un point sur lequel il faut donc appuyer : l’attachement, forcé ou libre, au terroir local, est encore une valeur vivace dans la France d’aujourd’hui, du moins pour peu qu’il y reste des habitants, car la société s’urbanise et les jeunes sont bien contraints d’aller chercher du travail ailleurs. Du reste, qui voudrait, même parmi les bobos écolos, ces rats des villes, passer l’année dans une campagne qui n’a pas toujours l’aspect souriant et ensoleillé de vacances estivales ? Il existe donc, même chez les « exilés » des villes, chez ceux qui sont contraints de partir, et qui reviennent régulièrement, une forte identité, qui leur donne un sentiment d’appartenance culturelle. On est breton, comme on est limousin. C’est pourquoi, dans un monde que l’on prétend « nomade », une grande partie de la population échappe au bougisme forcé, à l’anglais obligatoire, et aux délices du mélangisme. Ce qui, il faut bien le dire, aboutit parfois à une méfiance instinctive pour tout ce qui est étranger. Les « éducateurs », en ce domaine, ont parfois bien de la peine à faire entrer les préceptes de bien pensance dans le crâne de jeunes, qu’ils ne connaissent d’ailleurs souvent que de fort loin. Songeons que, contrairement à ce qui existait jadis, où les instituteurs et les professeurs de collège étaient bien des fois issus du cru, la plupart des enseignants résident à des dizaines de kilomètres de leur lieu de travail, dans la grande ville, et méprisent ces « ploucs » qu’ils ne sont pas éloignés de considérer comme des sauvages à évangéliser. On pourrait procéder aux mêmes remarques en ce qui concerne les valeurs sacrées de la bobotude triomphante, comme l’art contemporain ou l’homosexualité.
Cette France des terroirs ne se conquiert pas. Elle s’apprivoise, ou plutôt, c’est elle qui vous domestique, au sens littéral, qui vous accepte, vous accueille comme dans un foyer, une maison. Et c’est à vous d’être assez humble et large d’esprit pour vous plier au genre de vie local, qui est pétri de petits gestes, d’une façon bien spéciale de parler, de saluer, de demander son pain. Ici, tout le monde se connaît. A tel point que le seul événement qui ait encore du succès est l’enterrement, qui draine, comme une occasion de ressouder chaleureusement la communauté, tous les proches et les moins proches du défunt. C’est un rituel, un cérémonial, un geste de respect et de fraternité qu’il est difficile de récuser. Le village est une famille.
Les funérailles sont du reste là, pour beaucoup, la seule occasion de se rendre à l’église. Depuis une vingtaine d’années, les liens se sont relâchés entre la religion et les gens. Les anciens meurent, les jeunes ne se rendent plus à la messe. Phénomène commun partout, y compris dans les campagnes. Certes, les petits enfants sont sans doute plus nombreux qu’en ville à se rendre au catéchisme ou à faire leur communion, mais cela ne va pas plus loin, et ils se laissent happer, comme les adultes, par la nonchalance et l’irresponsabilité, l’indifférentisme et la paresse de cette vie moderne, qui ne rend un culte, finalement, qu’au travail productif.
Les prêtres sont rares, souvent très vieux, et sont dépassés par un labeur surhumain. Par la force des choses, ils ne peuvent plus donner une entière attention aux personnes. Ils paraissent quelque peu comme des fonctionnaires de tâches religieuses.
A y regarder de plus près, c’est peut-être là qu’est l’un des changements cruciaux des rapports humains, depuis quelques lustres. Lorsque je suis arrivé à Sainte Hermine des Sylves, j’avais l’impression d’une communauté, d’une complicité, même si les haines existaient, ou éclataient. Pour gagner son élection, le candidat à la magistrature communale tapait sur l’épaule en offrant l’apéro, avait toujours un mot gentil, et promettait une place pour le petit jeune. En général, il tenait parole. Il faut un chef, voilà la philosophie politique du lieu. Après l’élection, il peut faire ce qu’il veut, du moment qu’on reçoit l’essentiel, une certaine sécurité. Le lien possédait de la substance. Maintenant, tout semble plus ou moins froidement fonctionnel, le maire gère, la gendarmerie surveille, le maître d’école enseigne, le facteur distribue les lettres, mais dans l’air que l’on respire n’existe plus ce rayonnement chaud et pressant qui instituait l’impression forte de contribuer à une existence commune. Les trajectoires se sont individualisées, les comités des fêtes se sont évaporés, les grands projets fédérateurs ont disparu, et avec eux le plaisir des fêtes, des spectacles, des réjouissances, même si la nature de ces événements n’étaient pas d’un goût très sûr. Qu’importe ! on fabriquait des chars fleuris, on faisait venir des chanteurs populaires, on invitait des forains, on organisait des expositions de camions peints… C’étaient toujours des occasions de se revoir, et de rassembler les habitants du pays. On dirait que l’énergie et l’enthousiasme se sont dilués dans les plaisirs éparpillés, dans l’atomisation des volontés individuelles, en même temps que les jouissances se sont artificialisées, que les appareils modernes de transmission, internet, le portable, les jeux vidéo etc. ont vampirisé la libido et le temps. Il existe encore de grands banquets, à l’occasion de fêtes, de vide-greniers, de foires, mais le Mac do de la ville connaît un succès fou, on rêve d’Eurodisney, on joue frénétiquement au loto, et les jeunes, filles ou garçons, encore qu’ils savourent avec délectation la tradition culinaire locale, cochon, fromage, veau etc., ne savent plus très bien comment on fait cuire un œuf.
On trouve encore cette contradiction, entre attachement fort et désintérêt, dans le rapport avec la nature. Une part significative des gamins participent aux chasses paternelles, ou s’adonnent volontiers à la pêche. C’est même un enchantement de les faire parler. Beaucoup sont intarissables quand il s’agit de conversations relatives à ces loisirs, mais aussi quand il est question d’élevage de bovins ou de chevaux, d’agriculture, plus généralement d’existence campagnarde. On découvre chez eux un vocabulaire riche et précis. Mais Hors de là, c’est presque le néant. Il ne serait pas tragique si les nécessités de l’économie contemporaine n’imposaient d’autres horizons. Et c’est une source de malentendus, voire de mépris chez les bobos qui ne voient de salut que dans la transhumance vers la ville et ses intoxications. Une partie des jeunes gens, ici, font du Rousseau sans le savoir. Ils contredisent les clichés qu’on veut bien véhiculer au sujet des générations montantes, supposées vibrer pour l’agitation du monde moderne. Instinctivement, ils verraient leur bonheur dans les travaux agricoles, la vie dans la ferme ou la petite vallée, et ne souhaitent pas partager les enchantements du prétendu bonheur urbain. Il ne faut pas, bien sûr, généraliser des cas qui sont néanmoins en nombre conséquent, mais cela explique, pour une part, le peu d’appétence pour les carrières « intellectuelles », les ambitions professionnelles, et, plus généralement, pour les questions culturelles.
Cette contradiction se situe, du reste, à tous les niveaux, dans toutes les générations. Elle se traduit par un ancrage pragmatique dans la tradition qui persiste dans les modes de vie campagnards, la nourriture régionale perçue comme normale, les attitudes héritées des parents, et le conditionnement inévitable apporté par l’american way of life. Par exemple, on mangera jambon, pâté, saucisson en buvant du coca cola ; ou bien on se rassemblera près de la cheminée, on accueillera les amis, tout en omettant de fermer la télévision, qui fonctionne sans intermittence ; ou bien on organisera une grande fête, où sera invitée la grande fratrie des cousins, oncles, tantes, anciens etc., mais, au lieu de louer les services d’un groupe de musique traditionnelle, on paiera un pianoteur de synthétiseur ; ou bien on ne manquera aucun rassemblement champêtre, où se côtoient hommes et bêtes, mais on écoutera en battant la mesure cette soupe américaine qu’on a l’habitude de nous déverser maintenant dans les boutiques, les cafés, les rues et les espaces publics. La France profonde est pour ainsi dire schizophrénique, mais elle ne le sait pas ; du moins la contradiction qui met aux prises deux univers antithétiques n’est-elle pas perçue comme telle. Mais elle existe, contrairement à beaucoup de lieux urbains, où ne subsiste que la domination de la sous culture mondialisée.
Cela n’empêche nullement cette dernière de faire des ravages, et de contribuer à déraciner toujours davantage les habitants des campagnes. Il y a un peu plus de vingt ans, on découvrait avec malaise l’emprise phénoménale qu’exerçait la musique dite « techno » sur les enfants, qui en connaissaient à ce sujet plus que les adultes. Leur capacité d’absorption de la bouillie médiatique n’est explicable que par le temps consacré à toutes les sources qui la diffusent, mais aussi, il faut l’avouer, par la séduction toute particulière qu’elle offre aux pulsions infrahumaines. Nous ne comprendrons jamais le succès mondial du libéralisme si nous ne nous demandons pas s’il ne touche pas des zones réceptives à des stimuli aptes à désinhiber l’individu, et donc à le mettre en porte à faux avec les impératifs sociétaux et éthiques, désormais traduits comme des contraintes insupportables. L‘éducation est, pour cette raison, aussi négligée que dans les villes. Et d’ailleurs les parents ressemblent, par leurs goûts et leur consommation « culturelle », à leur progéniture, et semblent aussi américanisée qu’elle.
On remarque du reste que les dérèglements qui sapent la société se manifestent autant qu’ailleurs. L’une des causes du pourrissement des mentalités et des comportements a été, il y a quelque trente années, l’établissement d’une boîte de nuit, qui attira jusqu’aux gamins de quatorze ans, lesquels ne cessaient d’y faire allusion, bien plus souvent qu’à l’école. C’était là, somme toute, leur conception d’une certaine « éducation ». Non seulement on y apprenait à boire, mais on s’y initiait à toutes formes de drogues. Le trafic s’organisa, parfois avec des villes très éloignées, et de nombreux problèmes de santé, d’attitude, en résultèrent. Il était possible de croiser des jeunes gens dont l’accoutrement n’était guère différent que ceux qui font flores dans les banlieues. Au demeurant, pour peu que l’on converse avec des enfants, on est obligé de corriger invariablement un langage calqué sur les émissions de show business de la télévision. Ces gamins portent volontiers des T-shirts frappés du drapeau américain, anglais, du signe NY, ou de quelque inscription anglo-saxonne.
Pour ne pas demeurer tout à fait sur un signe négatif, il serait erroné de penser que personne ne réagit. J’ai eu la chance de rencontrer de nombreux adultes, d’un certain âge, autour de la quarantaine ou de la cinquantaine, souffrant de cet état désastreux de fait. L’intelligence, la lucidité, la clarté d’expression, la finesse d’analyse de ces personnes étaient merveilleuses, et pour tout dire, surprenantes pour un pessimiste comme moi. Il était évident que l’abattement devant ce qui ressemble à un tsunami de vulgarité et de destruction prend sa source dans l’impression que les êtres de bonne volonté sont ultra-minoritaires. Or, il n’est pas rare d’en croiser. Le problème est bien sûr que la partie saine de la société est atomisée. Parfois, des projets collectifs donnent corps à un état d’esprit partagé. Tel village s’organise pour restaurer une croix de chemin, par exemple.
J’ai discuté avec un acteur de cette restauration. Sa famille était établie dans le hameau depuis sept générations. Il m’a décrit par le menu les différentes étapes de transmission de son patrimoine, qui consistait une très belle ferme en grosses pierres, pourvue de plusieurs annexes. Sa fille et son gendre travaillaient à Lyon. Il ne pensait pas qu’ils allaient garder la propriété car son entretien s’avère très onéreux. Je sentais bien qu’il en était désespéré.
Nous ne saisirons pas la nature de notre sombre époque si nous n’avons pas conscience qu’elle représente l’un des deux ou trois grands retournements qui ont eu lieu depuis deux mille ans. Le premier a été la conversion de l’empire romain au christianisme, en 312. Puis, le deuxième date de la Renaissance. Le troisième se déroule sous nos yeux, et c’est la disparition de la paysannerie et de la culture paysanne, désormais presque achevée. Ce double génocide s’est produit sans révolte parce que sa durée relative, durant un siècle, voire un peu plus, s’est étalée dans le temps, sur plusieurs générations, et que l’exode n’a pas été perçu comme un mal, puisque de nombreux campagnards recherchaient une amélioration de leur confort de vie. Néanmoins, c’est toute une civilisation qui a été engloutie. Civilisation qui subsistait plus ou moins enracinée il y a quelques dizaines d’années.
En effet, il est courant, lorsqu’on écoute des gens de plus de cinquante ans, de percevoir dans leurs propos un accent de nostalgie. Les années cinquante ou soixante prennent les apparences d’un paradis. On travaillait encore beaucoup manuellement, mais il y avait plus de travailleurs, les moutons traversaient le village, d’innombrables boutiques, cafés et ateliers n’avaient pas été coulés par les supermarchés et les révolutions dans le mode de travail, peu de gens possédaient une voiture ou un téléphone, ce qui obligeait de se rendre service. Aller rendre visite, une ou deux semaines, durant l’été, aux grands parents résidant au fin fond de la campagne, était considéré comme le loisir suprême. Les jeunes flirtaient, dansaient, s’amusaient, mais tout cela avait un air bon enfant, nullement l’aspect crispé et mortifère des lieux de distraction actuels. Il existait des riches, des pauvres, des minables, des gens intéressants, brillants, mais on appartenait à la même famille, les bourgeois locaux, catholiques, « protégeaient » leur « clientèle », et surtout l’humour prenait souvent le dessus. On retire l’impression qu’avant on riait et on s’amusait beaucoup, malgré des conditions de vie assez dures, qui rendaient d’ailleurs tout bienfait inestimable, bien davantage que dans notre époque d’abondance, où l’on se lasse de tout.
La vie n’est pas pour autant facile de nos jours. Des paysans se sont pendus, d’autres sont partis, des familles entières ont migré pour d’autres cieux, seuls les gros exploitants subsistent, les prés sont passés dans quelques mains, les « stabus » énormes ont proliféré, les jeunes paysans ont appris à standardiser leur production, à rendre plus efficace leur travail, au détriment d’un certain rapport avec la nature, la terre et les bêtes. La plupart des métiers anciens ont disparu. Ne subsistent que des emplois de service, d’aide à la personne, de domestiques, de « paysagistes » (jardiniers), de commerciaux… Phénomène social qui ne manque pas d’aligner les mentalités sur la norme. Les « assistés » se multiplient, les « cas sos », comme on dit. Les familles éclatent, se décomposent, se recomposent, se surcomposent (comme on parle de surendettement) autant que dans les villes, et parfois seulement après une ou deux années de cohabitation, souvent avec des enfants en bas âge. C’est une véritable épidémie, qui provoque des meurtres, des suicides, et des enfants « à problèmes », mais aussi, parfois, des situations burlesques.
Il faut faire le deuil d’une France, et d’une Europe, disparues. Elles ne reviendront jamais comme elles étaient. Cependant, si l’on fait la part de l’aliénation provoquée par l’américanisation des esprits et des mœurs, il faut reconnaître qu’il existe dans le peuple d’en bas encore une partie, sinon intacte, du moins susceptible de réaction. La difficulté est de lui parler avec un langage qu’elle entende, et de lui donner l’envie et le courage de réagir, de combattre contre les forces destructrices.Claude Bourrinet (Voxnr, 1er janvier 2012)